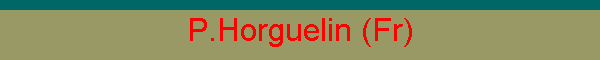* Une première version de cet article, rédigée en 1997, a été
publiée dans le bulletin du Club Histoire et Collection Radio (C.H.C.R) N° 22
du 2ème trimestre 1999. Celle-ci a été suivie d'une seconde version ,datée de juillet 2000,
qui est restée en ligne sur ce site jusqu'en 2009. Les informations beaucoup
plus précises recueillies depuis lors auprès de la famille Horguelin m'ont
conduit à rédiger cette 3ème version que l'on doit maintenant considérer
comme un bref résumé de l'ensemble du site.

Paul HORGUELIN
(1899-1967)
Un grand constructeur
méconnu*
Au sortir de la première guerre mondiale, la télégraphie sans fil a déjà
plus de vingt années d'existence. Des militaires aux boursiers, des marins aux
horlogers, nombreux sont les professionnels à "trouver leur compte"
dans cette technologie déjà éprouvée qui simplifie les communications et
abolit les distances. Condamné à se contenter de l'audition (en morse) des
bulletins météorologiques et des signaux horaires émis depuis la Tour Eiffel,
le "grand public" n'éprouve lui même encore aucune passion pour ces
traits et ces points mystérieux auxquels seuls quelques amateurs
"éclairés" savent donner du sens. Il ne lui viendrait en tout cas
pas à l'idée d'investir dans un appareillage aussi complexe et coûteux d'où
sortent des "bruits" si peu spectaculaires. Tout va changer en 1922
avec l'apparition des premières émissions parlées.
Compliqués, difficiles à régler, nécessitant l'usage de batteries
promptes à se répandre sur les parquets et de lampes à la durée de vie
incertaine, les récepteurs de radio sont pourtant, au début des années 20,
l'objet d'une demande sans cesse croissante du public, sans commune mesure en
tout cas avec celle à laquelle devaient faire face les quelques fabricants
"sérieux" qui occupaient le terrain avant 1914. Commerçants,
passionnés ou passionnés voulant faire de leur passion un commerce, nombreux
sont ceux qui, avec plus ou moins de bonheur et de compétence (souvent moins
que plus) "s'essayent" à ce nouveau marché et tentent de satisfaire
cette nouvelle demande. Au total, l'annuaire de la radioélectricité de 1923
recense déjà en France plus de 800 nouveaux constructeurs. A côté des
Ducretet, Vitus, Hurm, Péricaud, Lucien Lévy, reconnus en leur temps et
aujourd'hui révérés par les collectionneurs, beaucoup qui n'eurent pas la
chance ou le talent de s'implanter durablement se verront rapidement relégués
dans les oubliettes de l'histoire. Constructeur provincial, discret et
relativement éphémère, Paul Horguelin se place dans cette dernière
catégorie. Plus que d'autres cependant il mérite d'en sortir. La collection de
Eric Verdier contribue modestement à cette reconnaissance.
Un peu d'histoire
La TSF en est encore à ses premiers balbutiements quand Paul Horguelin voit
le jour le 12 juin 1899 à Sommauthe (Ardennes), le village natal de sa mère, Flavie
Elisabeth Lallement, institutrice. Fils d'Auguste Horguelin, lui aussi
instituteur (à Saint-Etienne-au temple, Marne) et petit fils de Jean-Baptiste
Horguelin, propriétaire foncier et maire de Vésigneul-sur-Marne, Paul
Horguelin est issu d'une famille provinciale cultivée alliant le culte de la
terre et le prestige social associé aux fonctions d'enseignement dans la France
rurale du début du siècle. Rien dans son ascendance ne le prédestine
particulièrement à participer à une aventure industrielle ou scientifique.
Alors que Paul Horguelin est encore un enfant, son père meurt brutalement et sa
mère prend la succession à l'école de Saint-Etienne. Il est bientôt envoyé
en pension à l'école de Malroy, près de Montigny-le-Roi (Haute-Marne) et sa
mère obtient sa mutation à Nuisement, près de Châlons-sur-Marne, un
"gros" village doté d'une gare facilitant les visites. Élève
brillant, Paul Horguelin passe avec succès le certificat d'études, puis un
baccalauréat, et entreprend des études d'agronomie à l'institut Agricole de
Beauvais. Pourtant, dès l'adolescence, sa passion est ailleurs. Curieux de
tout, il tend une antenne entre le clocher de l'église et le toit de
l'école (ou il réside avec sa mère ) afin de pouvoir capter, avec un poste à galène de sa construction,
les signaux horaires émis depuis la Tour Eiffel. En 1919, sa connaissance du
morse lui permet d'intégrer le service des transmissions des armées.
Dans l'armée du Rhin, puis à la Tour Eiffel, il est désormais en mesure
d'assouvir sa soif de savoir.
 Revenu à la vie civile, Paul Horguelin ne pense plus à l'agriculture. A
l'instar de nombreux "anciens" des transmissions, il mesure le
formidable avenir de la construction radioélectrique et ne songe qu'a profiter
des compétences encore rares que l'armée lui a permis d'acquérir. Au
printemps 1922,
il achète un terrain à Nuisement, qu'il pare bientôt d'un pylône métallique de
22 mètres (que les habitants du village appelleront "la Tour Eiffel")
avec
lequel il réalise des expériences de
transmissions sur les fréquences amateur. Parallèlement, il construit ses premiers
récepteurs à lampes dans une ancienne grange louée à cet effet, avec le
concours de 3 collaborateurs informels. Il voit son talent récompensé par
un "Grand Prix" lors d'une exposition de TSF organisée par le Concours Lépine
à l'été 1922 à Paris (le diplôme reçu à cette occasion figure en annexe)
. Ce n'est pas là une petite gratification car c'est
tout simplement le premier prix du tout premier "Salon de la Radio"
(qui ne porte pas encore ce nom) organisé en France. Placé en concurrence avec
les principaux constructeurs français, Paul Horguelin est considéré alors comme
rien de moins que le meilleur. A la suite de ce salon, l''afflux des commandes l'amène rapidement à développer
son affaire. C'est ainsi que le 5 novembre il crée avec ses 3 collaborateurs la
société "Radio-Techna" dont l'objet est la fabrication et la distribution des
appareils du même nom. Les débuts de Radio-techna sont pour le moins chaotiques.
Le 12 décembre la société est dissoute après seulement un mois d'existence
à la suite d'un différent entre les actionnaires. Paul Horguelin, qui a déjà
embauché quelques salariés, entend poursuivre son activité en nom propre mais
il est bientôt arrêté dans son élan quand, dans
la nuit du 9 au 10 janvier 1923, l'atelier est entièrement détruit par un
incendie. D'autres se seraient découragés mais Paul Horguelin est de la trempe
des personnes qui vont de l'avant. Un nouvel atelier est construit et la fabrication des récepteurs Radio-Techna peut
reprendre quelques mois plus tard. Aux yeux de ses
concitoyens ruraux, Paul Horguelin
est encore un illuminé. Pourtant l'affaire devient vite florissante. Au volant
de sa camionnette, il parcours les campagnes, fait des démonstrations et, quand
de l'objet magique sortent voix et musiques, rapporte des commandes. Un
premier rayon de TSF Radio-Techna est ouvert à Châlons-sur-Marne au sein de la
librairie Robat et des contrats sont noués avec plusieurs
entreprises parisiennes (Radio-Consortium, S.A.F.I.R) pour lesquelles il
réalise des gammes de récepteurs. L'entreprise prend véritablement son envol
en 1924 quand Paul Horguelin, fort de nombreux contacts dans le Sud-Ouest de la
France (liés à des circonstances familiales), travaille à implanter un
réseau de distribution solide entre Bordeaux et Toulouse. Point d'orgue de
cette entreprise de conquête de territoire,
un appareil Radio-Techna est choisi par le Conseil Général du Lot et Garonne
en vue d'équiper les mairies du département à la suite de la mise en place de
l'émetteur privé mais d'intérêt public "Radio-Agen". En 1925 l'atelier de
Nuisement compte 7 ouvriers-monteurs, Radio-Techna rayonne dans tout le grand
Sud-Ouest grâce à un magasin implanté à Agen. Paul Horguelin commercialise
ses radios sous de nombreuses marques dont Radio-Parfait, E Delidon (un
revendeur de Marmande) et aussi Radio-Toulouse (la célèbre station privée de
radio pour laquelle il fabrique des postes à galène). Il n'est plus question
de considérer notre entrepreneur comme un illuminé quand, à 26 ans à peine,
il est le premier employeur, l'homme le plus riche, l'homme le plus respecté,
bref, l'homme le plus important de son village.
Revenu à la vie civile, Paul Horguelin ne pense plus à l'agriculture. A
l'instar de nombreux "anciens" des transmissions, il mesure le
formidable avenir de la construction radioélectrique et ne songe qu'a profiter
des compétences encore rares que l'armée lui a permis d'acquérir. Au
printemps 1922,
il achète un terrain à Nuisement, qu'il pare bientôt d'un pylône métallique de
22 mètres (que les habitants du village appelleront "la Tour Eiffel")
avec
lequel il réalise des expériences de
transmissions sur les fréquences amateur. Parallèlement, il construit ses premiers
récepteurs à lampes dans une ancienne grange louée à cet effet, avec le
concours de 3 collaborateurs informels. Il voit son talent récompensé par
un "Grand Prix" lors d'une exposition de TSF organisée par le Concours Lépine
à l'été 1922 à Paris (le diplôme reçu à cette occasion figure en annexe)
. Ce n'est pas là une petite gratification car c'est
tout simplement le premier prix du tout premier "Salon de la Radio"
(qui ne porte pas encore ce nom) organisé en France. Placé en concurrence avec
les principaux constructeurs français, Paul Horguelin est considéré alors comme
rien de moins que le meilleur. A la suite de ce salon, l''afflux des commandes l'amène rapidement à développer
son affaire. C'est ainsi que le 5 novembre il crée avec ses 3 collaborateurs la
société "Radio-Techna" dont l'objet est la fabrication et la distribution des
appareils du même nom. Les débuts de Radio-techna sont pour le moins chaotiques.
Le 12 décembre la société est dissoute après seulement un mois d'existence
à la suite d'un différent entre les actionnaires. Paul Horguelin, qui a déjà
embauché quelques salariés, entend poursuivre son activité en nom propre mais
il est bientôt arrêté dans son élan quand, dans
la nuit du 9 au 10 janvier 1923, l'atelier est entièrement détruit par un
incendie. D'autres se seraient découragés mais Paul Horguelin est de la trempe
des personnes qui vont de l'avant. Un nouvel atelier est construit et la fabrication des récepteurs Radio-Techna peut
reprendre quelques mois plus tard. Aux yeux de ses
concitoyens ruraux, Paul Horguelin
est encore un illuminé. Pourtant l'affaire devient vite florissante. Au volant
de sa camionnette, il parcours les campagnes, fait des démonstrations et, quand
de l'objet magique sortent voix et musiques, rapporte des commandes. Un
premier rayon de TSF Radio-Techna est ouvert à Châlons-sur-Marne au sein de la
librairie Robat et des contrats sont noués avec plusieurs
entreprises parisiennes (Radio-Consortium, S.A.F.I.R) pour lesquelles il
réalise des gammes de récepteurs. L'entreprise prend véritablement son envol
en 1924 quand Paul Horguelin, fort de nombreux contacts dans le Sud-Ouest de la
France (liés à des circonstances familiales), travaille à implanter un
réseau de distribution solide entre Bordeaux et Toulouse. Point d'orgue de
cette entreprise de conquête de territoire,
un appareil Radio-Techna est choisi par le Conseil Général du Lot et Garonne
en vue d'équiper les mairies du département à la suite de la mise en place de
l'émetteur privé mais d'intérêt public "Radio-Agen". En 1925 l'atelier de
Nuisement compte 7 ouvriers-monteurs, Radio-Techna rayonne dans tout le grand
Sud-Ouest grâce à un magasin implanté à Agen. Paul Horguelin commercialise
ses radios sous de nombreuses marques dont Radio-Parfait, E Delidon (un
revendeur de Marmande) et aussi Radio-Toulouse (la célèbre station privée de
radio pour laquelle il fabrique des postes à galène). Il n'est plus question
de considérer notre entrepreneur comme un illuminé quand, à 26 ans à peine,
il est le premier employeur, l'homme le plus riche, l'homme le plus respecté,
bref, l'homme le plus important de son village.
En 1928, le marché de la radio a changé. Il faut produire toujours plus
vite et réduire ses marges pour faire face à la concurrence. Entreprise encore
artisanale, la société châlonnaise est condamnée à se développer ou
à disparaître. Ingénieur plus que marchand, curieux de toutes les techniques
nouvelles, Paul Horguelin se désintéresse progressivement de la radio qui a
perdu le côté magique des débuts héroïques pour n'être plus désormais
qu'un simple moyen de "gagner sa vie". Aussi ne prend il pas le
risque de l'aventure industrielle. Dès 1929, il choisi l'enseigne phare du
moment et devient le premier revendeur Philips de Champagne. Quelques postes à
batteries Radio-Techna sont encore produits dans les ateliers de Nuisement
pour approvisionner les
campagnes non encore reliées au secteur, puis quelques très rares
postes secteur... et puis plus rien. En 1934, l'aventure Radio-Techna est
terminée. Comme le remarque Madame Marguerite Horguelin, ancienne
préposée à la gravure des plaques d'ébonite, devenue en 1929 son épouse,
c'est quand il a renoncé à sa vocation de constructeur que Paul Horguelin a
réellement commencé à gagner beaucoup d'argent.
à la concurrence. Entreprise encore
artisanale, la société châlonnaise est condamnée à se développer ou
à disparaître. Ingénieur plus que marchand, curieux de toutes les techniques
nouvelles, Paul Horguelin se désintéresse progressivement de la radio qui a
perdu le côté magique des débuts héroïques pour n'être plus désormais
qu'un simple moyen de "gagner sa vie". Aussi ne prend il pas le
risque de l'aventure industrielle. Dès 1929, il choisi l'enseigne phare du
moment et devient le premier revendeur Philips de Champagne. Quelques postes à
batteries Radio-Techna sont encore produits dans les ateliers de Nuisement
pour approvisionner les
campagnes non encore reliées au secteur, puis quelques très rares
postes secteur... et puis plus rien. En 1934, l'aventure Radio-Techna est
terminée. Comme le remarque Madame Marguerite Horguelin, ancienne
préposée à la gravure des plaques d'ébonite, devenue en 1929 son épouse,
c'est quand il a renoncé à sa vocation de constructeur que Paul Horguelin a
réellement commencé à gagner beaucoup d'argent.
 Au début des années 30 Paul
Horguelin est un revendeur important. Il dispose d'un magasin somptueux à Reims
depuis 1928 environ, en fait construire un second à Châlons-sur-Marne et en
achète un troisième à Epernay. Il semble avoir un avenir tout
tracé alors que Philips s'impose comme le
premier constructeur de radios européen. Pourtant il n'est pas homme à se
laisser bercer par son statut social envié de commerçant aisé. De retour en
193O d'un voyage à travers la Russie stalinienne, son envie
d'entreprendre ne l'a pas quittée. A l'abri du besoin, il peut donner libre
cours à une autre de ses passions, bien différente : l'apiculture. A la tête
d'une ferme de 600 ruches (la plus importante de France), Président de la
société "API-TECHNA", pionnier en Europe d'une nouvelle
technologie du miel , Président du Syndicat des Apiculteurs
Français (UNAF), vice-président de la Fédération Internationale des
Apiculteurs (APIMONDIA), Paul Horguelin va connaître dans son nouveau métier
une réussite fulgurante que seul son décès prématuré, survenu le 3 avril 1967, à la veille d'un congrès ou il devait se rendre à
Washington, viendra stopper. Touche à tout de génie, également maire de sa
commune, juge au tribunal de commerce de Châlons et important propriétaire
foncier du châlonnais, Paul
Horguelin laisse aujourd'hui derrière lui l'image d'un grand notable de
province, craint et respecté, mais aussi celle d'un "self made man"
qui n'a jamais eu peur de passer pour un original en allant toujours de l'avant
quand le conformisme rural le poussait à "rentrer dans le rang".
Au début des années 30 Paul
Horguelin est un revendeur important. Il dispose d'un magasin somptueux à Reims
depuis 1928 environ, en fait construire un second à Châlons-sur-Marne et en
achète un troisième à Epernay. Il semble avoir un avenir tout
tracé alors que Philips s'impose comme le
premier constructeur de radios européen. Pourtant il n'est pas homme à se
laisser bercer par son statut social envié de commerçant aisé. De retour en
193O d'un voyage à travers la Russie stalinienne, son envie
d'entreprendre ne l'a pas quittée. A l'abri du besoin, il peut donner libre
cours à une autre de ses passions, bien différente : l'apiculture. A la tête
d'une ferme de 600 ruches (la plus importante de France), Président de la
société "API-TECHNA", pionnier en Europe d'une nouvelle
technologie du miel , Président du Syndicat des Apiculteurs
Français (UNAF), vice-président de la Fédération Internationale des
Apiculteurs (APIMONDIA), Paul Horguelin va connaître dans son nouveau métier
une réussite fulgurante que seul son décès prématuré, survenu le 3 avril 1967, à la veille d'un congrès ou il devait se rendre à
Washington, viendra stopper. Touche à tout de génie, également maire de sa
commune, juge au tribunal de commerce de Châlons et important propriétaire
foncier du châlonnais, Paul
Horguelin laisse aujourd'hui derrière lui l'image d'un grand notable de
province, craint et respecté, mais aussi celle d'un "self made man"
qui n'a jamais eu peur de passer pour un original en allant toujours de l'avant
quand le conformisme rural le poussait à "rentrer dans le rang".
Un constructeur à part entière
 Au début des années 20, s'intituler "constructeur" de récepteurs
radioélectriques est à la portée de tout le monde ou presque. Quelques
tournevis, quelques forets et quelques pinces sont les seuls outils
incontournables pour débuter une activité commerciale, un coin de table pas
trop encombré suffit le plus souvent pour faire un atelier. Pourvus en pièces
détachées standardisées réalisées par des fabricants spécialisés (Bardon,
Brunet, Far, Wireless Thomas...), la plupart des petits constructeurs se
contentent de percer les façades en ébonite, de rassembler les éléments dans
un coffret en bois verni en suivant les schémas de câblage proposés par
centaines dans la presse spécialisée (La TSF Moderne, Radio Amateur, l'Onde Électrique...) et enfin (suprême instant), d'apposer leur plaque constructeur
sur le produit fini. Miracle, ça fonctionne ! ... et pourtant, peu nombreux
parmi ces "spécialistes" sont ceux qui savent dire pourquoi.
Au début des années 20, s'intituler "constructeur" de récepteurs
radioélectriques est à la portée de tout le monde ou presque. Quelques
tournevis, quelques forets et quelques pinces sont les seuls outils
incontournables pour débuter une activité commerciale, un coin de table pas
trop encombré suffit le plus souvent pour faire un atelier. Pourvus en pièces
détachées standardisées réalisées par des fabricants spécialisés (Bardon,
Brunet, Far, Wireless Thomas...), la plupart des petits constructeurs se
contentent de percer les façades en ébonite, de rassembler les éléments dans
un coffret en bois verni en suivant les schémas de câblage proposés par
centaines dans la presse spécialisée (La TSF Moderne, Radio Amateur, l'Onde Électrique...) et enfin (suprême instant), d'apposer leur plaque constructeur
sur le produit fini. Miracle, ça fonctionne ! ... et pourtant, peu nombreux
parmi ces "spécialistes" sont ceux qui savent dire pourquoi.
Perfectionniste et amoureux des belles choses, Paul Horguelin ne conçoit pas
son activité de construction radioélectrique comme la plupart de ses
contemporains. A l'image des plus grands, des Ducretet, Vitus ou Horace Hurm, il
veut créer son style, sa marque de fabrique reconnaissable entre toutes. Il
veut donner à ses appareils le cachet auquel ne peuvent prétendre les
assemblages hétéroclites construits "à la va-vite" par des
commerçants peu scrupuleux pour répondre à la demande sans cesse croissante
d'une clientèle inexpérimentée et crédule. Disposant de peu de moyens, il
veut pourtant devenir un vrai constructeur.
Traduction concrète de cette ambition d'excellence, les premiers récepteurs
montés dès 1922 dans les ateliers de Nuisement se hissent d'emblée au niveau
des meilleurs. Visiblement inspiré par les productions anglaises contemporaines
en raison de nombreux séjours effectués en Angleterre et dans les îles
Anglo-Normandes, Paul Horguelin ne veut voir implantés dans ses appareils que
des composants de première qualité que les fabricants français ne sont
généralement pas en mesure de lui fournir. Ainsi, la plupart des pièces
mécaniques utilisées font l'objet de fabrications spécifiques. Des manettes
aux condensateurs, des selfs aux boutons ou aux rhéostats de chauffage des
lampes, tout ce qui compose les récepteurs Radio-Techna est le fruit de
l'inspiration du maître des lieux. Surdimensionnées, les pièces mécaniques
en laiton verni dont se couvrent les façades rappellent les appareils
militaires qu'il a côtoyés durant son Service National. Finement gravées par Marguerite
Brisson, future madame Horguelin, grâce à
une machine spécialement importée d'Angleterre, les faces avant en ébonite
délivrent à l'utilisateur toutes les informations utiles pour faire
fonctionner l'appareil. Objets d'un brevet spécial, les boutons à flasque plat
et à
de Nuisement se hissent d'emblée au niveau
des meilleurs. Visiblement inspiré par les productions anglaises contemporaines
en raison de nombreux séjours effectués en Angleterre et dans les îles
Anglo-Normandes, Paul Horguelin ne veut voir implantés dans ses appareils que
des composants de première qualité que les fabricants français ne sont
généralement pas en mesure de lui fournir. Ainsi, la plupart des pièces
mécaniques utilisées font l'objet de fabrications spécifiques. Des manettes
aux condensateurs, des selfs aux boutons ou aux rhéostats de chauffage des
lampes, tout ce qui compose les récepteurs Radio-Techna est le fruit de
l'inspiration du maître des lieux. Surdimensionnées, les pièces mécaniques
en laiton verni dont se couvrent les façades rappellent les appareils
militaires qu'il a côtoyés durant son Service National. Finement gravées par Marguerite
Brisson, future madame Horguelin, grâce à
une machine spécialement importée d'Angleterre, les faces avant en ébonite
délivrent à l'utilisateur toutes les informations utiles pour faire
fonctionner l'appareil. Objets d'un brevet spécial, les boutons à flasque plat
et à  butoir central apportent une touche d'originalité par rapport aux
traditionnels boutons à jupe ou à index adoptés par la grande majorité des
constructeurs. Ils sont fabriqués à l'unité et gravés mécaniquement dans
les ateliers de l'école des Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne. Le montage des appareils est l'objet d'un suivi constant.
Ainsi, les câbleurs sont placés sous la surveillance étroite du patron qui, secondé
par sa mère, impose à tous son autorité et le principe du "zéro
défaut". Comme le remarque en 1998 Marguerite Horguelin, les
employés "marchaient droit" à Nuisement, d'autant plus droit que la
mère du patron avait pris l'habitude de tout observer depuis une lucarne
dérobée et qu'à l'époque le licenciement n'était pas un problème. Suprême
audace en 1924, alors que la plupart des appareils concurrents se présentent
avec des lampes apparentes, la majorité des récepteurs construits sous la
marque Radio-Techna sont déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des "lampes intérieures", c'est à dire des
appareils où les tubes sont dissimulés du regard de l'utilisateur.
butoir central apportent une touche d'originalité par rapport aux
traditionnels boutons à jupe ou à index adoptés par la grande majorité des
constructeurs. Ils sont fabriqués à l'unité et gravés mécaniquement dans
les ateliers de l'école des Arts et Métiers de Châlons-sur-Marne. Le montage des appareils est l'objet d'un suivi constant.
Ainsi, les câbleurs sont placés sous la surveillance étroite du patron qui, secondé
par sa mère, impose à tous son autorité et le principe du "zéro
défaut". Comme le remarque en 1998 Marguerite Horguelin, les
employés "marchaient droit" à Nuisement, d'autant plus droit que la
mère du patron avait pris l'habitude de tout observer depuis une lucarne
dérobée et qu'à l'époque le licenciement n'était pas un problème. Suprême
audace en 1924, alors que la plupart des appareils concurrents se présentent
avec des lampes apparentes, la majorité des récepteurs construits sous la
marque Radio-Techna sont déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des "lampes intérieures", c'est à dire des
appareils où les tubes sont dissimulés du regard de l'utilisateur.
Les appareils
Réalisés en petites séries, voire à l'unité en fonction de l'inspiration
du jour du patron, les récepteurs conçus par Paul Horguelin n'ont pas fait
l'objet de beaucoup de publicité dans la presse spécialisée des années 20.
Loin du tumulte parisien, il n'était pas nécessaire pour vendre de faire
écrire sur soi. Il suffisait en fait de faire parler de soi, si bien
qu'aujourd'hui, la documentation n'est pas très abondante. On doit se contenter
de 3 petits fascicules édités entre 1925 et 1928 auxquels s'ajoutent une
notice concernant l'alimentation des récepteurs et un catalogue édité par un
revendeur de Lille en 1928. Fort heureusement, Paul Horguelin avait pris
l'habitude de photographier ses appareils (du moins certains d'entres-eux) et
par l'un de ces miracles qui n'arrivent qu'une fois dans une "carrière" de
collectionneur, ces clichés existent toujours.
Dix huit années de recherches m'amènent aujourd'hui à
penser que la production Radio-Techna est à la fois importante en nombre (à l'échelle de
l'époque bien entendu) et diversifiée.
 Des divers points de repère acquis au fil des discussions avec
Marguerite
Horguelin, il ressort que la capacité de production des ateliers devait
dépasser 1000 appareils par an, ce qui établit le maximum à 7000 si l'on
considère seulement les années de pleine activité (de 1924 à 1930). Le nombre assez considérable d'appareils
trouvés par moi même et d'autres collectionneurs au cours des dernières
années m'amène à penser que la réalité n'est sans doute pas très
éloignée de ce chiffre. L'examen de certaines pièces comptables, retrouvées
en 2009, permet de situer la production totale aux environs de 3000 à 5000
unités ce qui reste très conséquent. Peu implanté sur Paris, Paul Horguelin a réalisé
une part importante de ses ventes sur la région Champagne, une région agricole
certes, mais une région viticole également, à la fois riche et proche de Paris et des
premiers émetteurs de radiodiffusion, une région aussi où la concurrence
était certainement moins rude que dans la capitale ( Les établissement Sky de
Reims qui ont eu également une production importante, la société
Radio-Stanislas de Nancy qui a beaucoup essaimé dans la région). Beaucoup d'appareils ont par ailleurs
été vendus dans le grand sud-ouest grâce au "poste avancé" établi
à Agen. N'oublions pas qu'il s'agit d'une région dans
laquelle des émetteurs ont été implantés très précocement ( "Radio-Agen"
bien sur des 1924 mais aussi "Radio-Toulouse" en 1925, qui considérait Paul Horguelin comme un
constructeur suffisamment sérieux pour lui confier la fabrication de ses
postes à galène). Il est évident que les chiffres de production des ateliers
Radio-Techna restent très inférieurs à ceux de Ducretet, de Vitus, de
Radio-LL , de Péricaud et de quelques autres. Il est évident aussi qu'ils sont supérieurs
ou au moins égaux à ceux de certains autres manufacturiers, tels Horace Hurm,
André Hardy ou Louis Ancel, que les collectionneurs classent généralement
parmi les "grands constructeurs" alors même que le faible nombre
d'appareils survivants confirme bien qu'il s'agissait en fait de toutes petites
entreprises. Au final, on peut penser que la seule chose qui différencie
nettement Paul Horguelin de ces pseudo "grands constructeurs" est le budget
que ces derniers consacraient à la "réclame". La publicité les a
fait connaître des amateurs à l'époque et elle "fonctionne" encore
aujourd'hui très bien dans les représentations des Radiophiles quand il s'agit
de juger de" l'importance", de "l'intérêt" ou encore du
"juste prix" d'un appareil particulier. Aucun des entrepreneurs cités ici n'a "fait fortune" en
fabricant des radios mais certains se retourneraient aujourd'hui dans leurs
tombes en découvrant l'impact à rebours de leurs stratégies marketing auprès
de certains collectionneurs, plus enclins à courir derrière les
appareils étalés en pleine page dans la presse spécialisée des années 20 qu'a ouvrir les
tiroirs de l'inconnu (1).
Des divers points de repère acquis au fil des discussions avec
Marguerite
Horguelin, il ressort que la capacité de production des ateliers devait
dépasser 1000 appareils par an, ce qui établit le maximum à 7000 si l'on
considère seulement les années de pleine activité (de 1924 à 1930). Le nombre assez considérable d'appareils
trouvés par moi même et d'autres collectionneurs au cours des dernières
années m'amène à penser que la réalité n'est sans doute pas très
éloignée de ce chiffre. L'examen de certaines pièces comptables, retrouvées
en 2009, permet de situer la production totale aux environs de 3000 à 5000
unités ce qui reste très conséquent. Peu implanté sur Paris, Paul Horguelin a réalisé
une part importante de ses ventes sur la région Champagne, une région agricole
certes, mais une région viticole également, à la fois riche et proche de Paris et des
premiers émetteurs de radiodiffusion, une région aussi où la concurrence
était certainement moins rude que dans la capitale ( Les établissement Sky de
Reims qui ont eu également une production importante, la société
Radio-Stanislas de Nancy qui a beaucoup essaimé dans la région). Beaucoup d'appareils ont par ailleurs
été vendus dans le grand sud-ouest grâce au "poste avancé" établi
à Agen. N'oublions pas qu'il s'agit d'une région dans
laquelle des émetteurs ont été implantés très précocement ( "Radio-Agen"
bien sur des 1924 mais aussi "Radio-Toulouse" en 1925, qui considérait Paul Horguelin comme un
constructeur suffisamment sérieux pour lui confier la fabrication de ses
postes à galène). Il est évident que les chiffres de production des ateliers
Radio-Techna restent très inférieurs à ceux de Ducretet, de Vitus, de
Radio-LL , de Péricaud et de quelques autres. Il est évident aussi qu'ils sont supérieurs
ou au moins égaux à ceux de certains autres manufacturiers, tels Horace Hurm,
André Hardy ou Louis Ancel, que les collectionneurs classent généralement
parmi les "grands constructeurs" alors même que le faible nombre
d'appareils survivants confirme bien qu'il s'agissait en fait de toutes petites
entreprises. Au final, on peut penser que la seule chose qui différencie
nettement Paul Horguelin de ces pseudo "grands constructeurs" est le budget
que ces derniers consacraient à la "réclame". La publicité les a
fait connaître des amateurs à l'époque et elle "fonctionne" encore
aujourd'hui très bien dans les représentations des Radiophiles quand il s'agit
de juger de" l'importance", de "l'intérêt" ou encore du
"juste prix" d'un appareil particulier. Aucun des entrepreneurs cités ici n'a "fait fortune" en
fabricant des radios mais certains se retourneraient aujourd'hui dans leurs
tombes en découvrant l'impact à rebours de leurs stratégies marketing auprès
de certains collectionneurs, plus enclins à courir derrière les
appareils étalés en pleine page dans la presse spécialisée des années 20 qu'a ouvrir les
tiroirs de l'inconnu (1).
Au plan de la diversité, chaque année nous amène son lot de surprises. Au
moment d'écrire ces lignes, le cumul des appareils différents et des variantes
en notre possession, connus dans d'autres collections ou simplement à travers
les documents photographiques d'époque communiqués par la famille Horguelin, abouti à un total de
112 (un nombre auquel s'ajoute quelques appareils dont je connais l'existence
mais dont je n'ai pu me procurer de photos) Sachant que 2 façades identiques
n'impliquent pas nécessairement un schéma semblable, que seulement une petite
partie des
appareils recensés aujourd'hui dans les collections figurent dans la
photothèque de la famille Horguelin, pourtant forte de plus de 60 photos
d'appareils, il semble
que l'on soit encore très loin du compte (si vous connaissez un Radio-Techna,
n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice). Au total, nous comptons
déjà 4 variantes du poste à 5 lampes de 1924, 4 variantes du mono lampe de
1924, 3 variantes du 4 lampes type B4 de 1928... Une diversité incroyable,
nullement dictée par des impératifs commerciaux et que l'on ne peut
réellement comprendre si l'on ne prend pas la mesure de l'extraordinaire force
créative de Paul Horguelin, toujours prêt à essayer, à tester une idée, à
changer, à recommencer sans jamais se satisfaire entièrement du résultat.
Disposant sur place de tous les outils, tours, fraiseuses, machine à
graver et personnel abondant, il disposait en fait aussi de tous les
moyens pour faire "exister" rapidement les fruits de son
imagination, avant qu'une nouvelle idée ne chasse la précédente.
cumul des appareils différents et des variantes
en notre possession, connus dans d'autres collections ou simplement à travers
les documents photographiques d'époque communiqués par la famille Horguelin, abouti à un total de
112 (un nombre auquel s'ajoute quelques appareils dont je connais l'existence
mais dont je n'ai pu me procurer de photos) Sachant que 2 façades identiques
n'impliquent pas nécessairement un schéma semblable, que seulement une petite
partie des
appareils recensés aujourd'hui dans les collections figurent dans la
photothèque de la famille Horguelin, pourtant forte de plus de 60 photos
d'appareils, il semble
que l'on soit encore très loin du compte (si vous connaissez un Radio-Techna,
n'hésitez pas à apporter votre pierre à l'édifice). Au total, nous comptons
déjà 4 variantes du poste à 5 lampes de 1924, 4 variantes du mono lampe de
1924, 3 variantes du 4 lampes type B4 de 1928... Une diversité incroyable,
nullement dictée par des impératifs commerciaux et que l'on ne peut
réellement comprendre si l'on ne prend pas la mesure de l'extraordinaire force
créative de Paul Horguelin, toujours prêt à essayer, à tester une idée, à
changer, à recommencer sans jamais se satisfaire entièrement du résultat.
Disposant sur place de tous les outils, tours, fraiseuses, machine à
graver et personnel abondant, il disposait en fait aussi de tous les
moyens pour faire "exister" rapidement les fruits de son
imagination, avant qu'une nouvelle idée ne chasse la précédente.
Dans ce cadre flou figurent néanmoins quelques grandes lignes
directrices :
-Les récepteurs précoces :
Il s'agit des appareils produits dans le premier atelier avant l'incendie du 9
janvier 1923. On a peu d'informations sur ces appareils sinon quelques photos
d'époque. La production était certainement très faible. De juin à octobre
1922, Paul Horguelin produit des appareils pour le compte de la société SIDPE
(voir pages suivantes) avec le concours de 3 collaborateurs informels. La
fabrication des postes Radio-Techna débute le 5 novembre 1922 mais les 3
collaborateurs, devenus entre-temps des associés, quittent l'entreprise le 12
décembre. Pour finir, l'atelier est détruit le 9 janvier suivant. La
succession des évènements dommageables sur cette courte période n'a
certainement pas facilitée le travail de Paul Horguelin. Quelques très rares
appareils survivants, fabriqués immédiatement après la reprise d'activité,
permettent de se faire une idée plus précise des premiers appareils
Horguelin...mais les "vrais" premiers manquent à l'appel.
- Le récepteur mono lampe communal :
Fabriqué entre septembre 1924 et la mi-1925, il est, selon Marguerite Horguelin, le tout premier des
Radio-Techna (mais cette assertion est assurément fausse). Décliné en plusieurs variantes
successives, l'appareil se présente sous
une forme originale qui le distingue d'emblée de toutes les productions
contemporaines. De faibles dimensions (L 27, H 20, P 12), il est équipé d'un
condensateur variable, d'un variomètre, d'un rhéostat de chauffage et d'une
self interne à prise (certains modèles réalisés vers 1925-26 seront équipés de selfs
externes amovibles). Destiné à l'écoute au casque, ce récepteur à lampe
intérieure peut éventuellement se voir adjoindre un amplificateur à 1 ou 2 lampes
BF afin de permettre une audition en haut-parleur. De mêmes dimensions,
l'amplificateur 2 lampes est muni d'un rhéostat de chauffage et d'un inverseur à 3
positions destiné à sélectionner le nombre de lampes utilisé (on retrouvera
ce même inverseur sur des modèles plus tardifs). Cet appareil a équipé les
communes du Lot et Garonne (voir la page "Le monolampe Communal" pour
de plus amples informations). L'ébénisterie du monolampe communal sera ensuite
utilisée à de nombreuses fins par Paul Horguelin. On la retrouve sur un
générateur basse fréquence, un chargeur de batteries, un poste à galène.
- Les récepteurs à 5 lampes de 1924-25 : Il s'agit de postes de haut de
gamme, pour la plupart équipés d'un voltmètre, de 2 condensateurs variables,
d'un variomètre, de selfs internes divisées et d'un ou deux rhéostats de
chauffage (voir les modèles figurant dans la collection et sur les photos
d'époque). Les boutons à butoir central sont remplacés par des boutons à
jupes rehaussés de flasques en aluminium, le diamètre des bornes est plus
important que sur les mono lampes et un casier spécial est aménagé à
l'arrière pour les batteries. En dépit de façades très proches, les schémas
varient considérablement d'un modèle à l'autre. Ces modèles étaient sans
doute fabriqués en très petites séries.
-Les récepteurs à 4 lampes de 1925-26 :
Après une tentative pour intégrer
dans un seul coffret allongé le mono lampe et son ampli (voir le modèle
présenté dans la collection), Paul Horguelin adopte un modèle d'ébénisterie
aux formes plus conventionnelles. Deux condensateurs variables, un variomètre,
des selfs internes divisées, deux rhéostats de chauffage et un inverseur à 3
positions pour sélectionner le nombre de lampes utilisées équipent ces
modèles. On trouve parfois aussi un voltmètre (voir les modèles figurant dans
la collection) et plusieurs modèles de boutons, à butée centrale, à jupe rehaussée
d'aluminium, à jupe crantée pour pouvoir utiliser des prolongateurs
anti effet de main. Là encore, les schémas varient considérablement d'un
modèle à l'autre.
-Les récepteurs en coffret :
Des les débuts de Radio-Techna, Paul Horguelin réalise des postes en coffret,
à 3 puis 4 lampes. L'aspect général rejoint celui des autres appareils
contemporains avec des pièces de décolletage en laiton très largement
dimensionnées. Le modèle à 4 lampes de 1924 semble avoir fait l'objet d'une
production en assez grande série. Un autre modèle à 4 lampes, plus tardif,
utilise le même coffret. On trouve encore en 1926 un très gros poste à 5
lampes en coffret mais dans ce cas le HP est incorporé dans le couvercle.
Enfin, en 1928, Paul Horguelin présente en modèle dit "de voyage"
incorporant le HP, le cadre et les batteries dans une seule valise en cuir épais.
-Les récepteurs à lampes extérieures :
Paul Horguelin misait surtout sur
les postes à lampes intérieures mais il a fabriqué aussi quelques postes à
lampes extérieures sous la marque Radio-Techna. Je connais en fait seulement 3
appareils à lampes extérieures arborant la marque Radio-Techna. Il s'agit en
premier lieu d'un appareil à 2 lampes de 1922-23 présent dans la photothèque
Horguelin, en second lieu d'un appareil à 2 lampes de 24 présent dans ma
collection, en troisième lieu d'un appareil à 4 lampes vers 1927 visible dans
une collection hollandaise mais dont je n'ai pas pu me procurer de photos.
Les photos Horguelin montrent également quelques amplificateurs à 3, 4, 5 et même 7 lampes
extérieures destinés à être accouplés à une boite d'accord, mais nous
n'en avons jamais vu dans les collections. Il est probable que ces "lampes extérieures"
correspondent à des commandes spéciales et qu'ils n'ont jamais été
fabriqués en série. On trouve dans les productions Horguelin d'autres
appareils à lampes extérieures mais qui n'arborent pas la marque Radio-Techna.
L'un d'entres eux est seulement marqué "P. Horguelin", d'autres
portent une autre marque, d'autres enfin ne portent aucune marque et ne sont
identifiables comme des appareils Horguelin qu'en observant leurs composants.
-Les récepteurs "tardifs" :
A partir de 1927, Paul Horguelin
"rentre dans le rang" et les postes Radio-Techna se banalisent. Alors
que la radioélectricité devient une industrie, le constructeur chalonnais est
condamné pour survivre à produire de plus en plus vite pour faire face à une
demande grandissante. Manifestement, le coeur n'y est plus. Les composants
spécifiques laissent peu à peu la place à des pièces détachées achetées
dans le commerce, la qualité du travail de câblage baisse. Seule originalité,
commune semble t'il à tous les Radio-Techna de cette période (qui ont perdu
leurs plots en façade), un incroyable inverseur PO.GO dans lequel on reconnaît
la "patte" de l'ingénieur qui "veut se faire plaisir".
Seuls les appareils de haut de gamme, tels les "Super-Techna-Luxe" et
"Technadyne" présentés dans la collection, ou encore le "Super-Technadyne" à
ébénisterie à rideau coulissant, échappent en partie à la dérive. Contre
un supplément de 250 F, ces appareils sont équipés de boutons spéciaux dit
"à réglage automatique" avec indication des longueurs d'ondes. Ces
boutons sont gravés à l'unité en fonction des caractéristiques d'étalonnage
du poste et aucun n'est identique aux autres.
se banalisent. Alors
que la radioélectricité devient une industrie, le constructeur chalonnais est
condamné pour survivre à produire de plus en plus vite pour faire face à une
demande grandissante. Manifestement, le coeur n'y est plus. Les composants
spécifiques laissent peu à peu la place à des pièces détachées achetées
dans le commerce, la qualité du travail de câblage baisse. Seule originalité,
commune semble t'il à tous les Radio-Techna de cette période (qui ont perdu
leurs plots en façade), un incroyable inverseur PO.GO dans lequel on reconnaît
la "patte" de l'ingénieur qui "veut se faire plaisir".
Seuls les appareils de haut de gamme, tels les "Super-Techna-Luxe" et
"Technadyne" présentés dans la collection, ou encore le "Super-Technadyne" à
ébénisterie à rideau coulissant, échappent en partie à la dérive. Contre
un supplément de 250 F, ces appareils sont équipés de boutons spéciaux dit
"à réglage automatique" avec indication des longueurs d'ondes. Ces
boutons sont gravés à l'unité en fonction des caractéristiques d'étalonnage
du poste et aucun n'est identique aux autres.
-Les récepteurs de commande : A côté de sa gamme spécifique, Paul
Horguelin a souvent réalisé des appareils à la demande d'autres entreprises.
Ces appareils sont entièrement conçus dans les ateliers de Nuisement et empruntent
les mêmes composants. La présentation varie toutefois à la demande
du client : SIDPE, S.A.F.I.R, Radio-Toulouse, Radio-Consortium (voir le modèle
présenté dans le Guide des radios françaises de collection de Mr Guy Biraud) ou
encore E Delidon. Certains modèles spécifiques existent à la fois sous la
marque Radio-Techna et sous d'autres marques (voir le modèle présent dans la
collection sous la marque Radio-Parfait et figurant dans les photos d'époque
sous la marque Radio-Techna). Bien entendu, la liste n'est pas exhaustive et sera sans doute
complétée par des découvertes futures. Parmi ces appareils certains sont à
"lampes extérieures". Je n'ai jamais trouvé d'appareils de
sous-traitance postérieurs à 1926, ce qui laisse supposer qu'après cette date
Paul Horguelin s'est exclusivement consacré à Radio-Techna.
Paul Horguelin a aussi réalisé quelques meubles radio de grand luxe destinés à des intérieurs cossus
et fabriqués à l'unité en fonction des désirs du client, quelques postes
secteur à haut-parleur incorporé qui n'ont plus rien de Radio-Techna, sinon le
nom ... assurément, l'avenir ne manquera pas d'apporter son nouveau lot de
découvertes.
Eric Verdier.
(1) : Ces quelques lignes mériteraient à elles seules un
long article, qui j'écrirais sans doute un jour. Que les collectionneurs qui se
sentent visés se rassurent, je ne considère pas les constructeurs cités ici
comme méprisables, loin de là. Il reste que la collection radio, comme
d'autres, mériterait à mon sens une approche un peu plus historienne et un peu
moins consumériste.
SUITE DU
DOSSIER RADIO-TECHNA

RETOUR AU MUSEE





 MUSEUM
MUSEUM